Deux idées fausses ont miné notre économie, mais on ne nous en parle jamais. Il faut en avoir conscience car il est important de pouvoir identifier les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons, aujourd’hui, avec une économie aussi poussive, une économie qui est apathique et a un faible taux de croissance. Aussi, nos gouvernants, depuis un demi-siècle, se trouvent-ils contraints de recourir chaque année à la dette pour procurer aux Français un niveau de vie satisfaisant. Et il est curieux que les chercheurs en économie aient négligé de le faire, du moins à notre connaissance, car c’est seulement en décelant les raisons qui sont à l’origine de l’apathie de notre économie que l’on pourra être en mesure de corriger la situation et de remédier aux maux qui nous accablent.
Il s’agit, nous allons le voir, de deux courants de pensée qui ont eu des effets déterminants sur la manière dont s’est structurée notre société : d’une part, la charte d’Amiens de 1906 qui, au début du XXe siècle, a instillé le marxisme dans notre syndicalisme ouvrier, et, de l’autre, la vision erronée qu’ont eue de grands sociologues comme Daniel Bell aux États-Unis et Alain Touraine en France de ce qu’est une « société postindustrielle », en interprétant mal, comme ils l’ont fait, les conclusions que Jean Fourastié avait tirées de ses travaux dans l’ouvrage magistral qu’il avait publié en 1949 : « Le grand espoir du XXe siècle » (PUF). On ne fait jamais de la conjugaison de ces deux phénomènes la cause véritable de l’affaiblissement de notre économie et de la régression de notre pays au plan mondial. La France n’est plus la grande puissance qu’elle était autrefois, et dans la période récente elle est passée, en matière de PIB, de la 4eme place en 1976 à la septième aujourd’hui ; et, en matière de PIB/capita, de la 13e, en 1980, à la 24e à présent.
Quelques rappels historiques :
Chacun sait que la France a été longtemps, dans son histoire, le pays le plus puissant d’Europe : sa force, en ces temps reculés, tenait à la fois à sa démographie et à sa richesse agricole. Au Moyen-âge, elle était, en Europe, l’unité territoriale la plus peuplée, comptant presque autant d’habitants que tous ses grands voisins réunis. A cette époque, c’était la démographie qui assurait la richesse d’un pays et permettait de gagner les batailles.
Au XVIIIe siècle, arriva d’Angleterre la révolution industrielle, et l’on vit alors la France commencer à perdre du terrain. Notre pays prit sur la Grande Bretagne au moins une quarantaine d’années de retard, et le « take-off », selon Rostow, se situa seulement dans la période 1830-1860.
Ensuite, la démographie et la production se sont ralenties, et il y eut, en 1870, la sévère défaite de Sedan, et avec elle la fin du Second-Empire. Il faut bien voir le retard pris à cette époque par la France. En 1851, 64 % de la population active dans notre pays était encore employée dans l’agriculture, contre 21 % seulement en Grande Bretagne ! Et, autre indication sur notre retard en matière d’industrialisation : l’importance de la production de houille et de lignite, comme l’indique le tableau ci-dessous :
Production de houille et de lignite
(Tonnes par habitant)
| France | Royaume-Uni | Allemagne | USA | |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | 0,94 | 3,87 | 1,82 | 2,25 |
| 1900 | 1,23 | 4,12 | 2,62 | 3,12 |
| 1913 | 1,57 | 4,20 | 3,87 | 4,97 |
Le marxisme qui a infesté notre syndicalisme a pris naissance, au milieu du XIXe siècle, avec Karl Marx et Friedrich Engels, et il a trouvé en France un terrain très favorable à son développement.
Il a apporté, comme idée nouvelle, que la lutte des classes est le moteur de l’histoire, et il a proclamé qu’une loi naturelle veut que, dans l’évolution des sociétés, succède inévitablement au capitalisme, à la fin de l’évolution, une société où il n’y a plus de classes sociales et où il n’existe plus d’exploitation de l’homme par l’homme : en somme une société idéale.
Le marxisme veut, en effet, que la société s’approprie collectivement les moyens de production en en dépossédant les bourgeois et les capitalistes, et Karl Marx considérait que l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs, eux-mêmes. La doctrine marxiste, comme on le sait, a ébranlé le monde au XXe siècle, et la Charte d’Amiens en a été, en France, l’un des vecteurs.
La charte d’Amiens de 1906
Peu de personnes ont en mémoire la date de 1906, et c’est pourtant celle où se produisit un événement qui allait avoir des répercutions considérables sur notre économie : il s’agit de la fameuse « Charte d’Amiens ».
C’est, en effet, en 1906 que se tint à Amiens le IXe congrès confédéral de la CGT qui avait pour objet de fixer les objectifs et le mode de fonctionnement du syndicalisme en France. Les congressistes eurent à arbitrer entre 3 motions différentes :
- Celle des Guesdistes qui proposait de subordonner le syndicat au parti socialiste ;
- Celle d’Auguste Keufer, de la fédération du Livre, qui avait un caractère strictement économique, et ,
- Celle de Victor Griffuelhes, le secrétaire général de la CGT, qui fixait comme objectif l’expropriation capitaliste avec, comme moyen d’action, la grève générale.
C’est cette motion d’inspiration marxiste qui triompha à la quasi unanimité (830 voix sur 839 votants), une motion qui donna au syndicalisme pour rôle de transformer la société par « l’expropriation capitaliste ».
Elle stipulait que le syndicalisme doit agir en toute indépendance des partis politiques, se suffisant à lui-même avec comme moyen d’action la « grève générale ». Et il était dit, dans cette motion : « Le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, demain groupement de production ». L’objectif final assigné au syndicalisme était donc bien une société à la façon dont, plus tard, les bolcheviques l’institueront en Union Soviétique.
Il a résulté de la Charte d’Amiens que le syndicalisme français a eu deux caractéristiques particulières : la lutte des classes, avec pour objectif l’expropriation capitaliste, et l’action directe plutôt qu’une collaboration avec les partis politiques.
Dans les pays du Nord, et en Suisse, le syndicalisme, contrairement au notre, n’a pas été révolutionnaire mais réformateur. En Allemagne, il a collaboré avec le SPD et l’on a débouché sur la cogestion des grandes entreprises ; en Suisse, les syndicats et le patronat ont conclu en 1937 un accord qui s’est appelé « la paix du travail », par lequel il a été convenu que les conflits du travail se régleraient dorénavant par la négociation, et non pas par des grèves ou des lock-outs, et il n’y a jamais plus eu de grève dans ce pays.
En France, avec cette orientation marxiste prise par notre syndicalisme, on en est resté à la lutte des classes, et cela a considérablement nui au bon fonctionnement de notre économie. Nos chefs d’entreprise ont été continuellement entravés dans leurs actions, et ils se sont trouvés soumis par les Pouvoirs publics à un code du travail très lourd qui a beaucoup bridé leur dynamisme.
Il faut rappeler quelques événements marquants. Et tout d’abord, après la grave crise de 1929, le « Front Populaire » de 1936. Les premières grèves eurent lieu dans l’aéronautique, puis elles s’étendirent au secteur de l’armement, et le mouvement se propagea très vite dans toute la France, touchant même les commerces et la grande distribution.
On compta un peu plus de 12.000 grèves, dont 9.000 avec occupation d’usines. Finalement le pays se trouva complètement paralysé, et le 7 juin, à l’initiative du gouvernement, le patronat et les syndicats signèrent les « Accords Matignon ».
Il y eut ainsi les premiers congés payés (15 jours), une forte augmentation des salaires, et une semaine de 40 heures au lieu de 48 h. Et dans la ligne de la charte d’Amiens on procéda à la nationalisation des usines d’armement ainsi que des chemins de fer ( création de la SNCF) et l’on plaça la Banque de France sous tutelle.
Il y eut, comme conséquence, une forte dévaluation du franc par Léon Blum le 17 novembre 1936. Pendant que les Français faisaient la révolution, de l’autre côté du Rhin Hitler était allé réoccuper la Rhénanie qui avait été démilitarisée, et dans un discours, il avait annoncé, sans que l’on s’en inquiétât, le réarmement de l’Allemagne, en violation complète des clauses du traité de Versailles.
Ensuite, au lendemain de la seconde guerre mondiale, il y eut l’application, en 1945, du programme du « Conseil National de la Résistance » (CNR), qui avait été préparé dans la clandestinité par la CGT et la CFTC. Il était d’inspiration totalement marxiste, prônant « le retour à la nation des grands moyens de production, des richesses du sous-sol, des grandes banques et des compagnies d’assurance ».
On nationalisa à tour de bras : les Houillères, la sidérurgie, les grandes entreprises industrielles (Renault, Gnôme&Rhône, la Snecma… ); ensuite, le secteur bancaire, les assurances, puis les compagnies de gaz et d’électricité. Et il y eut deux grandes avancées sociales : la Sécurité Sociale, et les Comités d’entreprise. Et on inscrivit le droit de grève dans la Constitution.
Le mouvement se calma pendant toute la période de reconstruction de notre économie par le général de Gaulle, le Commissariat Général au Plan jouant un rôle utile de concertation, mais les luttes syndicales reprirent, ensuite, avec notamment les communistes à nouveau au pouvoir avec Mitterrand et son « Programme Commun de la Gauche », en 1981.
Ce programme avait pour objectif de « changer la vie », et cela nous valut un bon nombre de nationalisations, la retraite à 60 ans, une augmentation du SMIC, une cinquième semaine de congés payés, etc…Toutes ces luttes du syndicalisme en France, si elles ne parvinrent pas à atteindre l’objectif final inscrit dans la Charte d’Amiens, à savoir l’installation d’une société communiste, amenèrent des avancées sociales considérables, beaucoup plus importantes que partout ailleurs, comme le montre le tableau ci-dessous :
Comparaison France-Pays nordiques -Suisse
| France | Allemagne | Danemark | Suisse | |
|---|---|---|---|---|
| Taux de Pop. Active | 46,7 % | 53,4 % | 53,0 % | 55,7 % |
| Durée vie active | 35,6 ans | 38,4 ans | 36,9 ans | 42,4 ans |
| Heures travail/an | 1.607h | 1.850h | 1.750h | 1.831h |
| Durée hebdo. travail | 35h | 37h | 37h | 45-50h |
C’est ainsi que c’est en France que l’on travaille à présent le moins, (au travail et par habitant) et que, en conséquence finale, nos entreprises ont à supporter des charges sociales bien supérieures à celles de leurs concurrents en Europe, des charges qui induisent un coût du travail extrêmement élevé et nuisent à leur compétitivité (en particulier à l’exportation).
La mauvaise interprétation de la loi dite des « Trois Secteurs de l’Economie », de Jean Fourastié :
Jean Fourastié, un grand économiste français a publié, en 1949, un ouvrage qui a eut un très grand retentissement : « Le grand espoir du XXe siècle ». Il a expliqué que lorsqu’une société se développe elle passe du secteur agricole (le secteur primaire), au secteur industriel (le secteur secondaire), puis du secteur industriel au secteur des services (le secteur tertiaire).
Cette loi générale était issue de ses travaux portant sur les évolutions des effectifs de main d’œuvre dans les sociétés. Très vite, de grands sociologues comme Alain Touraine en France et Daniel Bell aux États-Unis s’emparèrent du sujet, s’activant à décrire ce qu’est dans le monde moderne une société « avancée », et ils lancèrent la notion de « société postindustrielle », c’est-à-dire une société débarrassée de ses activités industrielles asservissantes et polluantes.
On parla donc de société nouvelle, une société « du savoir et de l’intelligence » dépourvue d’activités industrielles, celles-ci étant reversées sur les pays en voie de développement qui disposent d’une main d’œuvre abondante, bon marché, et corvéable à merci, tout ceci grâce à des transports maritimes devenus peu onéreux.
On vit donc plusieurs pays du monde s’organiser de la sorte, le schéma imaginé étant que les pays avancés seraient des sociétés de l’intelligence qui vendraient leur savoir aux pays du Tiers-Monde, lui achetant, en retour, les biens manufacturés dont ils ont besoin, ceci ayant pour avantage d’avoir des réfrigérateurs et des machines à laver pas chers.
Cela a donné finalement la Chine d’aujourd’hui qui est devenue l’usine du monde, et on est en passe, à présent, de très vivement le regretter !
C’est ainsi que la France, tout comme les États-Unis d’ailleurs, s’est très gravement désindustrialisée, les dirigeants laissant le pays perdre son secteur industriel sans broncher. Des pays comme l’Allemagne, ou la Suisse, par contre, ne sont pas tombés dans ce piège, tenant à conserver intacte leur industrie.
L’erreur commise par les sociologues a été de ne pas voir que Fourastié avait raisonné sur les effectifs et non pas sur les valeurs ajoutées : dans une société « postindustrielle » le secteur industriel n’a pas disparu : il emploie, certes, relativement peu de personnes, mais s’agissant du secteur qui est celui où la productivité croit le plus vite, sa valeur ajoutée reste importante dans le PIB, de l’ordre de 20 % à 25%.
Comment redresser la situation ?
Eh bien, il faut intervenir sur les obstacles que ces deux fausses bonnes idées ont posés sur la voie du développement de notre économie: réduire les avancées sociales extravagantes existant dans notre pays car elles sont par trop en avance sur le degré de développement de notre économie, et procéder activement à la réindustrialisation du pays.
Le syndicalisme, en France, n’a pas atteint les objectifs qu’il s’était fixés dans la Charte d’Amiens, mais les combats qu’il a menés sans avoir jamais aucun souci du « bien commun » du pays, puisqu’il s’était fixé comme objectif de renverser la table, ont fourni des avancées sociales démesurées eu égard au degré d’avancement de l’économie : des temps de travail bien plus courts que dans les autres pays, la gratuité des soins de santé et de l’enseignement, un départ à la retraite bien plus tôt que partout ailleurs, un code du travail beaucoup trop contraignant pour les employeurs, etc.
Et l’on a habitué la population a appeler cela des « acquis sociaux », c’est-à-dire des avantages obtenus par les luttes valeureuses des travailleurs contre le capitalisme. Il est donc quasi-impossible pour nos gouvernants de revenir en arrière, sur le plan social, d’autant qu’un « Nouveau Front Populaire » s’est mis en place : du moins faudrait-il un Javier Milei, et nous n’en avons pas !
Avec donc les handicaps de coûts qui pèsent sur nos entreprises pour financer ces « acquis sociaux » démesurés, et l’impossibilité de prendre des dispositions particulières pour soutenir et redresser notre économie (droits de douane, subventions, dérogations aux réglementations écologiques bruxelloises, etc…….) du fait de notre appartenance à l’Union Européenne, cette nouvelle entité économique supranationale dans laquelle la France s’est insérée, il va être extrêmement difficile de redresser notre économie. Notre pays ne pourra y parvenir qu’en obtenant de Bruxelles des dispositions dérogatoires particulières, le temps de redresser la situation et en faisant preuve de courage et de solidarité.
(Article paru dans la Revue Politique et Parlementaire du 3 février 2025)

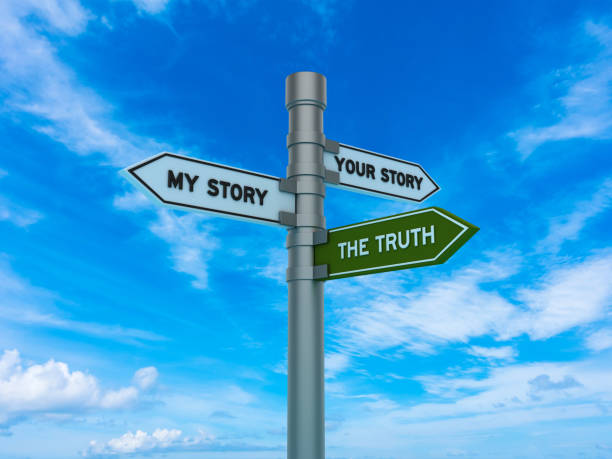
Laisser un commentaire