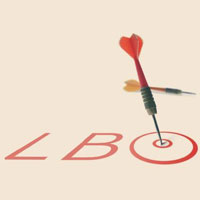Dans l’été 2002, le cabinet de Renaud Dutreil, nommé ministre des PME par Jacques Chirac quelques mois auparavant, nommait Bernard Zimmern en charge d’une commission d’enquête sur les Business Angels avec mission de lui rendre compte. Les motifs de nomination de Bernard Zimmern n’étaient pas ses succès comme innovateur ou sa défense des Business Angels, mais le fait qu’il avait fait l’ENA.
Devant cette commission, comparaissaient rapidement quelques champions de l’innovation comme Denis Payre mais aussi un jeune ingénieur des Ponts qui expliquait qu’en l’état des incitations fiscales, il était beaucoup plus lucratif financièrement, pour des fonds dits de capital-risque, d’investir dans du LBO que dans le financement de la création ou du développement de nouvelles entreprises.
Ces financements sont éminemment risqués et en l’absence de dispositifs réduisant le risque, il était infiniment moins aventureux de racheter des entreprises existantes pour les rendre plus compétitives et les revendre en faisant une marge importante sur la revente du titre. C’est le LBO, Leveraged buyout, souvent payé avec très peu de fonds de la part du fonds qui achète car l’opération est en très grande partie payée par des emprunts garantis par le patrimoine, notamment immobilier, de la société achetée.
Les publications régulières de l’AFIC, l’association qui rassemble la quasi-totalité des acteurs du capital-investissement du 8ème arrondissement, sinon de Paris ou de la France, semblent montrer que cette répartition des fonds s’est largement perpétuée sans qu’on puisse très bien distinguer parmi ces fonds la part aidée par des niches, des « dépenses budgétaires » comme se plaisent à les nommer ceux qui n’ont d’autres solutions pour réduire la dépense publique que de s’en prendre à ces aides étatiques.
Un article du Wall Street Journal semble annoncer la fin de cette ressource dont il faut bien dire qu’elle consistait souvent à dépouiller la firme de tous ses postes de dépenses non indispensables à court terme, comme recherche, marketing, et ce, de façon à présenter un compte de résultats et un bilan plus vendables. Dispositifs qui ne semblent pas avoir rencontré beaucoup de la colère de ceux qui dénoncent les riches, ou les aides d’État pour les riches.
Voici les raisons que donne le Wall Street Journal[[« The Glory Days of Private Equity Are Over », WSJ du 31 mars 2015]] pour la fin du LBO.
? Les taux d’intérêt commencent à remonter. La Fed ne va plus se contenter de maintenir les taux bas et va certainement procéder à leur hausse. Cette année ou l’année prochaine, peu importe. Cela signifiera inévitablement l’augmentation du coût du capital pour les investisseurs.
? Les banques américaines sont visiblement moins intéressées par les LBO qu’avant. Depuis 2013, elles font face à toute une série de réglementations qui empêchent notamment les emprunts de plus de six fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).
? La prochaine réforme fiscale semble inévitable. Les deux sénateurs républicains Lee et Rubio ont récemment soumis un plan de réforme qui proposait, entre autres, de supprimer les déductions fiscales des intérêts d’emprunts, si avantageuses pour les sociétés ayant eu recours au LBO. Pendant des années cet avantage fiscal était une des raisons du succès des LBO et faisait gonfler la bulle. Du point de vue du contribuable, il pourrait paraître injuste de payer des impôts sur les revenus financiers, alors que les sociétés bénéficient de la déduction fiscale des intérêts, qui ne fait qu’encourager leur endettement. Même si la proposition des sénateurs en question tombe dans les oubliettes, la question de symétrie dans l’imposition des intérêts restera toujours d’actualité. Ce sera une très mauvaise nouvelle pour les sociétés télécoms, fortement endettées.
? Il faut noter que les investissements LBO ne sont pas productifs et empêchent le développement de l’économie. Quand quelqu’un rachète, par exemple, une pharmacie ou une agence de location de voitures avec des emprunts, il ne fait pas d’investissement dans le sens propre de terme. De plus, le fait de réduire toutes les dépenses dans des nouveaux produits ou des services, nuit à la productivité de l’économie. Selon les estimations de l’auteur de l’article, les LBO sont responsables de la perte d’environ 0,5% à 1% du PIB américain.
? Les gros projets ne sont plus attractifs. Il faut se souvenir du plus gros LBO dans l’histoire, celui de l’Energy Future Holdings Corporation (précédemment Texas Utilities) réalisé par Kohlberg Kravis Roberts, Texas Pacific Group et Goldman Sachs en 2007 pour un montant de 48 milliards de dollars. Face à toute sorte de régulations et de lobbys écologistes, la société a dû déposer son bilan l’année dernière.
Autre exemple, le mois dernier : le fabricant hollandais de semi-conducteurs NXP a acquis pour 11,8 milliards de dollars Freescale, société historiquement issue de la branche semi-conducteurs de Motorola, pourtant rachetée à celle-ci en 2006 par Blackstone, Carlyle, TPG et Permira pour 17,6 milliards de dollars.
Conclusion, les sociétés à forte dépense en recherche et développement ne sont visiblement pas les meilleures candidates pour le LBO, puisque le remboursement des intérêts ne laisse aucune place à l’innovation.
Ainsi, c’est le retour aux fondamentaux : la création d’entreprises nouvelles plutôt que l’extraction de la dernière goutte de sang des vieilles entreprises.